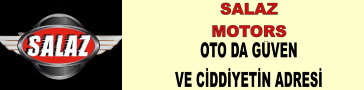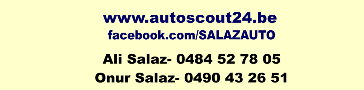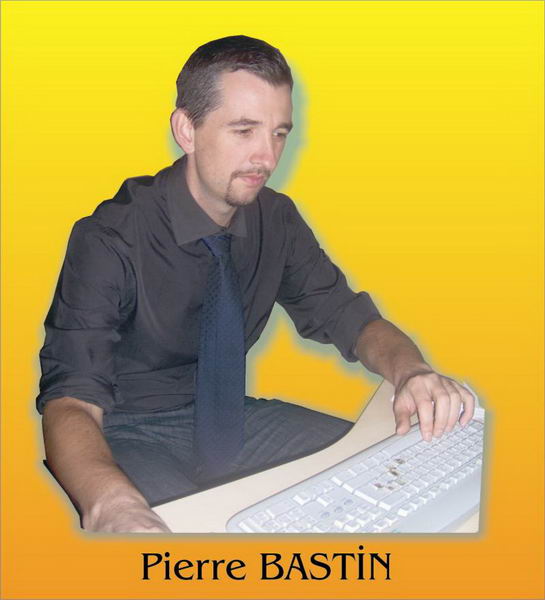Une histoire de codes ou quelques réflexions consécutives aux élections du 8 octobre. Chères lectrices et chers lecteurs, Il y a quelque temps, je vous avais fait part de ma passion pour la langue et la culture turques et de lâitinéraire qui
Une histoire de codes ou quelques réflexions consécutives aux élections du 8 octobre. Chères lectrices et chers lecteurs, Il y a quelque temps, je vous avais fait part de ma passion pour la langue et la culture turques et de lâitinéraire qui mâavait conduit à travailler dans la communauté turque de Bruxelles. Aujourdâhui, je voudrais vous parler de codes, non pas de codes secrets ou de codes de banque, mais bien de codes culturels. Le code, câest un ensemble de signes ou de références nous permettant de nous orienter, de savoir comment nous comporter dans une situation donnée. Le mot code renvoie aussi à un aspect caché, secret connu seulement de ceux qui lâutilisent. Le code, câest aussi ce qui permet lâaccès, ce qui nous permet dâouvrir une porte par exemple pour entrer dans un coffre ou encore dans une communauté. Assurément, les codes, les cultures ne sont pas partout les mêmes, ils diffèrent selon les pays, les communautés et même au niveau plus personnel selon les individus. « Très bien » me direz-vous, « mais cela nous le savions déjà , rien de nouveau donc ». Ce que je voudrais mettre en avant, bien maladroitement, câest la difficulté de communiquer ou même seulement de vivre ensemble si nous ne connaissons rien de lâautre, de sa façon de penser, de ce à quoi il accorde de lâimportance, de ce qui fait sens pour lui. Une culture, câest une langue, une façon de voir le monde, une façon de respirer, une façon de marcher, une façon de rêver et de construire son avenir⦠Le fait dâappeler « grand frère », « grande sÅur », « oncle », « tante » des inconnus croisés dans la rue ne nous en dit-il pas bien plus sur les liens sociaux régissant une communauté que bon nombre dâexplications savantes ? Peut-on connaître un pays, une culture en quelques jours ou quelques mois, en la résumant à quelques clichés ? Comment ne pas considérer avec ironie les déclarations de certains politiciens qui se découvrent, au détour de la campagne, « proches de la communauté turque ». Quel crédit apporter à de telles déclarations ? Mais je sors de mon sujet⦠La Turquie nâa-t-elle donc rien dâautre à offrir que des villages de vacances et les tours organisés, rien dâautre à montrer que la Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, aussi remarquables soient ces monuments ? La communauté turque de Bruxelles, est-ce seulement les pides, les döners et les doubles files de la chaussée de Haecht ? A lâheure où lâon parle dâintégration, nâest-il pas temps de prendre lâautre au sérieux et dâapprendre à le connaître ? Nâest-il pas temps de dépasser la vanité des discours pour multiplier les points de rencontre, les ponts entre les gens ? Savez-vous par exemple quâen Belgique, en dépit du nombre important de personnes dâorigine turque, il nâexiste pas de département de turcologie sérieux et quâil est donc pratiquement impossible dâapprendre le turc à un bon niveau. En outre, nâincomberait-il pas aux intellectuels dâorigine turque dâêtre aux côtés de leur communauté et de présenter de celle-ci une image plus juste et plus positive ? Malheureusement, nous devons bien constater que la plupart dâentre eux se sont coupés de la vie des quartiers, trop occupés à gagner une légitimité dans la société dâadoption. Ce faisant, ils laissent la place à ceux qui misent sur le communautarisme le plus étroit et qui tirent parti du repli identitaire. La suite, nous ne la connaissons que trop bienâ¦il nous suffit pour cela de prêter lâoreille aux échos de la campagne schaerbeekoise dans les grands quotidiens belges et de lire les métaphores animalières quâon y trouve. « Schaerbeek mérite mieux », assurémentâ¦les belges dâorigine turque également ! Que penser en outre de cette attitude bien connue de certaines « élites » qui consiste à tenir la Turquie et les hommes politiques de la communauté sous un feu nourri de critiques ? Pensent-ils que câest comme cela que lâon va promouvoir le dialogue et faire avancer les choses ? Le moment nâest-il pas venu de donner la parole à des personnes qui, parce quâils connaissent les deux codes, le « belge » et le « turc », et parce quâils travaillent sur le terrain, seraient en mesure de favoriser une véritable rencontre et lâaccès à une véritable citoyenneté ? Je pense quâil est temps également que les leaders dâorigine turque assument leurs responsabilités et travaillent dans le sens de lâouverture et du progrès de leur communauté. A ce titre, lâaccession dâun élu dâorigine turque au poste de secrétaire dâétat et peut-être plus tard de bourgmestre me semble être une chance historique pour la communauté turque de Belgique. A nous, à vous, chères lectrices et chers lecteurs, dâêtre au rendez-vous ! Pierre Bastin